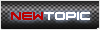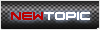Strangler a écrit:
Il y a effectivement très peu de candidat à l'agrégation de géo par rapport à l'histoire. En fait et en tous cas au capes histoire/géo, il y a aussi un net déséquilibre des candidats là dessus. Je me souviens en prépa 2006-07, sur 80 candidats à Limoges, 70 étaient historiens. Cela donne un avantage énorme aux géographes car inconsciemment, le jury met en valeur les géographes en leçon alors que les géographes sont souvent des bouchers pour les historiens en commentaire de doc à l'oral...
En fait, là je ne suis pas trop d'accord.
Je pense plutôt que les géographes sont mieux formés que les historiens pour ce concours, ou du moins, qu'ils sont, de par leur formation de géographe, meilleurs que les historiens.
La différence entre les historiens et les géographes de formation, c'est qu'il est plus facile pour un géographe de faire de l'histoire (du moins niveau capes), que pour un historien de faire de la géographie.
Au capes d'histoire, il y a deux critères qui fondent la réussite : la fonction "éponge" (c'est à dire, j'ingurgite un max de données et je les "recrache" juste après) ; et la fonction "réflexive" (c'est à dire être capable de donner une problématique qui tient la route, et un plan solide). La fonction éponge, que tu sois un lettré, un sociologue, un historien de l'art, un archéologue, un ethnologue, elle est "facile" à obtenir : il suffit de se connaître, de savoir comment on fonctionne pour "apprendre", et on apprend, peu importe quoi.
Par contre, c'est sur cet aspect réflexif que les historiens pêchent par "nature", et c'est là que les géographes battent les historiens.
En géographie, t'es amené à réfléchir beaucoup plus sur tes sujets que tu ne le fais en histoire. Raisonner par échelle, imbriquer dans un plan "universitaire en 3 parties" des réflexions sur l'espace, sur les acteurs, sur des dynamiques multiples, en y intégrant un vocabulaire et des outils géographiques, ça demande de l'entrainement, et ça booste l'intellect'.
En histoire, une fois que tu as compris le plan chrono-thématique ou le plan "nature-moyen-limites/évolutions", t'es capable de répondre à 95% des sujets proposés aux écrits et aux oraux. Par contre, dès que les sujets de géo sortent un peu des sentiers battus, les historiens sont perdus parce qu'ils n'ont jamais réellement appris à faire des plans et des problématiques géographiques. D'ailleurs, manque de peau pour les historiens, actuellement, la géographie a le vent en poupe dans les recherches en histoire ("lieux de pouvoir", "espace de violence", "frontières", et j'en passe), comme les approches sociologiques, anthropologiques, etc ("violence" ! "Tenir son rang" ! "
Etre une minorité" "
Etre romain").
Moralité, tes géographes (qui, comme tu l'as dit, ne représentent que 20 % des candidats), pendant leur année de prépa concours, n'ont qu'à apprendre les contenus des sujets d'histoire et renforcer celles de géo. Alors que les historiens, doivent apprendre les contenus des sujets d'histoire comme les géographes, mais en plus apprendre (souvent pour la première fois) à faire de la géographie.
Forcément, la différence se crée sur la géographie aux écrits. La masse ne savant généralement pas décoller des 8-9/20, les quelques vraies copies de géo voient leurs notations monter bien au-dessus de 10. Et leurs propriétaires sont très souvent des géographes, et/ou de bons étudiants. Alors que les copies d'histoire sont jugés à la fois sur les connaissances et sur le plan.
Cette année, aux écrits, pour faire un exemple, le sujet de géographie a été fatal : "Aménagements des territoires et mutations récentes de l'agriculture française" (En histoire, on a eu un sujet plutôt classique recoupant avec une approche anthropologique "Pouvoirs et violence dans les royaumes de France, Germanie et Bourgogne 888-XII°s").
Conséquence : le rectorat a demandé aux correcteurs de monter les notes de géographie parce qu'il n'y avait pas assez de candidats pour les oraux. A Lille, d'où j'suis originaire, et où la préparation de géographie est vraiment pas terrible, ils sont passé de 100 admissibles 2009 à +/- 50. Il y a, sur l'ensemble de la France, près de 300 admissibles de moins que l'an dernier. Et j'imagine qu'une grosse partie est sur le seuil d'admissibilité.
Reste les oraux : l'EOD en géographie est aussi une hantise de la plupart des candidats ne maîtrisant pas les outils et les évolutions épistémologiques de la géo. Alors que le géographe a vite appris les évolutions plutôt basiques séparant méthodiste-annales (1ère, 2ème et 3ème génération)-nouvelle histoire-histoire en miette.
On a tous déjà entendu les légendes sur des sujets d'eod de géographie impossible, du genre "géographie des nains de jardin", "géographie et vers de terre"... N'importe quel historien lambda s'évanouirait en découvrant ça sur son p'tit papier lors du tirage au sort. Alors qu'au final, on ne te demande juste de réfléchir sur l'objet (d'étude) en géographie.
C'est comme si tu avais "BD et histoire", ou "peut-on faire une histoire des lapins ?".
Dernier point : la leçon de géographie note plus les capacités d'utilisation du vocabulaire et des outils de la géographie (indices, modèles, échelles, approches multiscalaires, etc.), que de réelles connaissances de repérage dans l'espace (évidemment, une inculture géographique sera pénalisée). Alors qu'en histoire, ils sont obligés de pousser sur le fond et les connaissances parce que les plans sont presque toujours identiques d'un candidat à l'autre.
Personnellement, une fois le cafep-capes en poche (

), je viserai l'agrégation de géographie et/ou ferai de la recherche en géohistoire... (

).