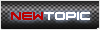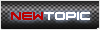Episode 2 : Darkness
Fair is foul and foul is fair
Hover through the fog and filthy air
~ The Weird Sisters (Macbeth, Shakespeare)~*~
Du fond de l'Auberge
Aux Trois Succubes, languissait une mélodie sinistre qui évoquait ce petit village perdu dans la brume (
https://www.youtube.com/watch?v=V4jTTWMHwcI).
Dehors, la nuit commençait à tomber.
Mais quelle surprise ! Si on ne lui avait pas d'avance indiqué cet homme, il est possible qu'il ne l'aurait jamais soupçonné.
Un aspect banal. Un côté misérable et miséreux. Un air idiot qui rappelle le crétin et l'ancien forçat.
Il avait quelque chose du savant ascétique mais, aussi étrange que cela puisse paraître, cependant du criminel.
Son visage évoquait une synthèse ratée entre Verlaine et Darwin [1], et qui aurait composé,
non pas quelque gloire pour la littérature ou pour la science, mais bien au contraire une honte, une abomination.
Enveloppé d'un pardessus vert trop grand pour lui, l'homme marchait comme un automate vers une petite table isolée.
Toujours la même, et qu'il occupait depuis des lustres, sans doute.
Il s'assit. Puis, il resta là un long moment, le regard vide, hébété.
Aristide n'en croyait pas ses yeux : lui qui s'était imaginé, tout au long de sa promenade en forêt, un homme respectable...
Le garçon de café, visiblement accoutumé à ses manies, se dirigea vers le pantin.
Comme si on venait de le tirer de profondes pensées, celui-ci demanda, le plus simplement du monde,
et comme pour se débarrasser d'un opportun, un café.
~**~
Aristide paya sa bière, se leva de son tabouret, puis se dirigea lentement vers l'homme seul,
tout en réfléchissant à une phrase pour amorcer la conversation.
Si une conversation avec un tel personnage était du domaine du possible.
" Monsieur, bonsoir. Je viens de la part d'une personne chère... Qui m'a recommandé à vous... "
- Bonsoir. Certainement. De qui s'agit-il ?
- Celimbrimbor.
Calmement, celui qu'Aristide considérait comme "un pauvre type",
sortit de l'immense poche de son pardessus un petit carnet sur lequel quelques notes semblaient avoir été jetées au hasard.
On pouvait lire :
Prendre sur soi, en soi, pour soi (...) Sans crainte (...) La peur est le premier moteur de l'errance.
La peur de perdre son statut social, son compagnon, sa vie, son argent, sa place, etc. La peur de l'autre (...)
L'idée de ce couple uni comme une barque sereine dans l’œil d'une tempête qui fait rage tout autour.
L'image me plaît beaucoup et correspond à ce que j'entends par acceptation de l'histoire (...)
S'ensuivrait non plus une lutte mais une coopération (...) [2]
Déplacer la volonté de puissance [3] de l'individu à une entité plus grande (...)
Thanos : de façon étonnante, il est le seul personnage de l'univers Marvel jusqu'ici développé auquel je me suis identifié.
Sans doute la certitude de sa défaite. Ainsi donc, Bite.Puis une note, en bas, au crayon de papier :
Oedipien. La peur de l'autre = la peur de La Femme.
D'où lutte transposée en discipline quotidienne.Mais pour toute compréhension de ce charabia psychologique, qu'il lisait à l'envers de la place où il se trouvait,
Aristide ne put saisir qu'un seul mot : "Bite".
Aussi, quand le mystérieux écrivain lui demanda s'il le connaissait bien,
la première réponse qui lui vînt immédiatement à l'esprit fût :
- Indubitablement.
~***~
L'homme rangea son petit carnet.
"Monsieur, dit calmement le personnage soi-disant célèbre (Aristide ne parvenait toujours pas à le croire),
je n'ai pas pour habitude de donner des informations au premier venu, et cela sous n'importe quel prétexte que ce soit."
- Je suis professeur. D'histoire-géographie.
- Certainement, répondit l'homme très lentement. Et comme si cette réponse lui suffisait amplement, il enchaîna :
Aussi, vais-je être très bref. J'ai effectivement rencontré Celimbrimbor, une seule fois, et c'était il y a fort longtemps.
J'étais alors à Londres, dans l'une de ces immenses bibliothèques de
la City.
J'ai échangé avec cet homme solitaire à propos d'une thèse sur Shakespeare.
La seule chose que j'ai retenue de notre conversation, était notre point de désaccord à ce sujet.
- Un point de désaccord au sujet de Shakespeare ? demanda Aristide, fort surpris qu'un tel homme, si fade,
pouvait se brouiller avec quelqu'un. Et cela, même si son interlocuteur était Celimbrimbor.
- Oui. J'avais avancé l'hypothèse que Shakespeare n'était autre que le chancelier Lord Bacon de Verulam [4].
Cela ne lui a pas plu. Pour lui, le dramaturge ne pouvait se confondre avec le savant.
Enfin, "aux Universités, les jeunes gens apprennent à croire", disait
le philosophe de l'induction.
Il esquissa un léger sourire en coin.
Dans cette remarque ironique, Aristide se surprit à noter une pointe de méchanceté pour son collègue.
- C'est pourtant une thèse intéressante, pousuivit-il, d'ailleurs, le dernier de nos grands psychologues [5] l'a évoqué,
mais, de nos jours, personne ne le lit comme il le mériterait et ne le prend plus du tout au sérieux.
- "Le dernier de nos grands psychologues" ? demanda Aristide, fort intrigué.
- Je fais référence à
Dionysos.
Aristide était un peu déconcerté. Qu'est-ce qu'il lui racontait, ce type ? Et pourquoi ce soudain changement de sujet ?
Le voilà qui me parle de Nietzsche, maintenant, pensa-t-il, mais je ne suis pas ici pour
parler philo.
Hors de question que j'entre sur ce terrain. Ma priorité est de savoir où est Celim.
Une réminiscence psychologique lui apparut soudainement devant les yeux :
cette conversation lui rappelait étrangement... Ce maudit rêve de
la Forêt du Monologue.
... Serait-il possible que tout soit lié ?
~****~
Pendant qu'il se perdait dans ses réflexions,
Aristide ne pouvait cependant pas s'empêcher de prêter attention aux bruits qui couraient autour de lui.
Curieusement, toutes les conversations lui semblaient tourner toutes autour des même sujets : le sexe et la violence.
Avec des voix bien trop aigües, des vieilles femmes ne mettaient aucun point d'honneur
à évoquer le nombre hallucinant de leurs conquêtes. Comme des veuves noires ou des mantes religieuses.
C'était à croire qu'elles n'avaient pas eu une seule jeunesse mais milles vies antérieures.
Un peu gêné, Aristide tourna discrètement la tête vers la droite : elles étaient d'une laideur à faire peur.
Tout en mastiquant ce qui devait être du rat crevé,
elles avalaient goulument le contenu rouge sang de leurs verres avec des bruits secs de déglutition.
Baissant les yeux, Aristide jeta alors un œil à gauche : un énorme gaillard, au poil roux comme un diable
et aux yeux bleus translucides, qui semblait venir d'une contrée étrangère, racontait comment il avait égorgé son père,
en pleine nuit, pendant que celui-ci se débattait dans son lit. Son compagnon de table, le regardant avec des yeux fous
et avides, souriait tout en laissant percevoir des canines saillantes trop aiguisées pour une mâchoire humaine.
"Deux criminels, pensa Aristide, peut-être des bandits de grand chemin. Décidément, cet endroit est de plus en plus louche,
on dirait un vrai guêpier !"
Portant les yeux un peu plus au loin, il vit près de la porte d'entrée un grand type trop maigre
assis à une petite table, tout seul. Il aiguisait des ongles immenses avec un couteau.
Au même moment, leurs regards se croisèrent comme deux lames mortelles.
Des yeux rouges haineux de chat errant plongèrent en un éclair sur le curieux
tombé de la Lune qui se retourna précipitamment vers l'homme qui était en face de lui.
"Vous faîtes allusion à Nietzsche comme un psychologue, et vous le nommez de son
pseudo,
quand il a complètement perdu la boule. Ce n'est pas sérieux. Avec tout le respect que je vous dois,
on m'a recommandé à vous comme la seule personne pouvant m'aider à retrouver mon ami.
Cette rencontre en Angleterre est un détail... Monsieur, je vous prie de bien vouloir m'indiquer, si cela est en votre pouvoir,
la moindre information que vous seriez susceptible de me fournir concernant Celimbrimbor."
Aristide avait prononcé cette phrase calmement mais avec détermination. " Ne rien lâcher. Rien."
Mais l'autre voulait entamer une guerre des nerfs, cela était de plus en plus évident.
Et avec une voix qui semblait surgir d'outre-tombe :
- Vie publique et ambition personnelle ne permettent pas toujours de se pencher avec probité sur certains sujets.
La folie n'est jamais rien d'autre qu'une trop grande lucidité.
Et tous les philosophes, pour ne pas faire de la science elle-même un problème, ne sont jamais rien d'autres que des savants.
Pas des juges, pas des critiques, pas des esprits libres. Mais des moralisateurs. Malgré eux.
Je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien, je dis qu'ils sont limités.
Qu'est-ce que le
SurHumain [6] ?
Quelque soit la nature des informations qu'il possédait, il voulait faire dire à Aristide des choses qu'il pensait lui-même.
Une
lueur morte passa soudainement dans ses yeux.
Des yeux injectés de sang.
~*****~
(A partir de maintenant, tout va s'accélérer. Aussi l'ambiance se rapproche-t-elle de ceci :
https://picosong.com/wQDJm).
Pas de doute possible, et cette fois il ne rêvait pas. Il avait parfaitement entendu.
On venait de lui reposer cette même question stupide. Pourquoi ?
- Ecoutez, Monsieur, je ne sais pas de quoi vous voulez parler...
Mais l'autre reprît calmement la conversation.
- La vérité est qu'il n'y a qu'une seule erreur : c'est celle qui consiste à croire que nous existons pour être heureux.
Non, 'Disciple Science' n'a pas dépassé 'Maître Art'. C'est l'épuisement consécutif qui l'a engendrée.
Nous n'avons plus aucune raison d'admettre qu'il y ait des intelligences supérieures à la nôtre pour nous sauver.
De fait, ce que révèle le soi-disant 'génie', c'est qu'il n'est nullement une abstraction mais une simple relation,
toujours à considérer par rapport à son milieu.
Que le génie et l'art appartiennent au passé, c'est parce que nous vivons une époque épuisée, faible et moraliste au possible,
par pure mesure préventive pour une vie dégénérée. A en juger par le train où vont les choses,
les gens feraient mieux d'investir dans les poubelles plutôt que dans le genre humain.
Tant que nous serons engagés dans cette voie par l'Optimisme, le monde nous paraîtra plein de contradictions.
On peut toujours essayer de rejeter la faute de son infortune sur les circonstances, ou sur les autres,
mais la recherche du bonheur n'en est pas moins manquée.
L'opinion généralement admise, que le but de la vie réside dans la pratique de ce qui est juste,
trahit déjà son insuffisance par la misérable petite quantité de vertu qu'on trouve parmi les Hommes.
Combien sont réellement honnêtes ? - Ils sont bien plutôt égoïstes, avides, envieux, heureux du malheur d'autrui ...
Ce dieu mauvais, ce Diable, que les témoins de Jehovah voient partout autour d'eux,
il est certain que le Chrétien commence d'abord par le ressentir en lui : c'est ainsi qu'il se sent pécheur, 'enfant du pêché'.
Les crimes et leurs conséquences seront uniquement effacés par la grâce.
La vertu morale n'est pas le but, mais un simple moyen pour y conduire.
La souffrance est le seul moyen capable de purifier, de renouveler l'Homme.
Nous avons plus à espérer d'elle que de nos actions.
L'affirmation du vouloir-vivre est un péché. Une opposition décisive à la nature est la seule rédemption.
La fin du monde est le salut.
Le criminel est le vrai saint qui porte en lui tous les stigmates des choses mauvaises mises au ban de la société.
Les super-vilains sont les vrais rédempteurs de l'humanité civilisée.
Quant aux super-héros, il disparaîtront avec la peine de mort, ce n'est qu'une question de temps ...
Aristide, tout en écoutant, cherchait à savoir à qui il avait affaire.
"Non, se dit-il en lui-même, cet homme-là n'est pas du peuple.
Bien sûr, comme tous les romanciers russes et chinois, il avait une prédilection pour la sociologie des petites gens.
Mais aussi fort qu'il voulait faire croire à son amour du peuple, il jouissait de ses souffrances."
- Monsieur, il me semble que vous aimez trop les criminels pour ne pas vous reconnaître en eux.
Une telle minutie dans la description des mœurs, une véritable manie [7].
Sauf votre respect, seriez-vous un sadique, Monsieur ?
La petite phrase avait sonné comme une escarmouche.
Et telle était bien l'intention d'Aristide qui supportait de moins en moins ce calme du personnage qui confinait à l'idiotie.
Ce sale type faisait tout ce qu'il pouvait pour se faire passer pour plus bête qu'il ne l'était,
mais Aristide commençait à y voir clair dans son jeu : si c'était ce qu'il voulait, c'est ce qu'il aura.
Une guerre psychologique dans un huis clos.
La tension dans la salle devenait palpable comme l'orage sous un ciel d'Eté.
- Vous semblez concevoir l'idéal du saint comme le tueur de Dieu libéré du parricide.
- L'archétype du savant moyen, est une sorte de Faust. Et par conséquent, il n'a pas "une crise de foi",
mais
la vision de l'Eternel Retour, qui, pour être acceptée, exige la mort de Dieu.
L'Eternel Retour est le problème de la Science. Et c'est bien tout le problème des savants.
... Qui parmi eux a réellement compris cette phrase : "Dieu est mort" ?
- Dois-je en déduire que pour vous, l'idéal de l'Homme est de tuer Dieu ?
Un méchant sourire apparût sur le masque du psychologue.
- C'est une
Battle of the Brains. Selon moi, le cerveau qui pense
tout est subjectif [8]
est supérieur à celui qui affirme
everything is relative [9].
Mais vous semblez être enfin disposé à discuter. Aussi, si vous me le permettez, j'aimerais vous raconter une petite histoire.
~******~
Il y avait sur la Terre un certain philosophe qui niait tout, absolument tout : les lois, la conscience, la foi...
Surtout, la vie future.
Il mourut en pensant entrer dans les ténèbres du néant, et le voilà en présence de la vie future.
Il s’étonne, il s’indigne : "Cela, dit-il, est contraire à mes convictions."
Et il fut condamné pour cela... - Excuse-moi, je te rapporte cette légende comme on me l’a racontée -
Donc, il fut condamné à parcourir dans les ténèbres un quatrillion de kilomètres
(car nous comptons aussi en kilomètres au Paradis, maintenant), et, quand il aura achevé son quatrillion,
les portes du Paradis s’ouvriront devant lui et tout lui sera pardonné.
Le condamné au quatrillion regarde donc autour de lui, puis se couche en travers de la route :
"Je ne marche pas, par principe je refuse !"
Prends l’âme d’un athé russe éclairé et mêle-la à celle du prophète Jonas,
qui bouda trois jours et trois nuits dans le ventre d’une baleine, et tu obtiendras notre penseur récalcitrant.
Mais non, au bout de mille ans, il se leva et il marcha.
La Terre s’est déjà reproduite peut-être un million de fois; elle s’est gelée, fendue, désagrégée,
puis décomposée dans ses éléments, et de nouveau les eaux la recouvrirent.
Ensuite, ce fut de nouveau une comète, puis un soleil d’où sortit le globe.
Ce cycle se répète peut-être une infinité de fois, sous la même forme, jusqu’au moindre détail.
C’est mortellement ennuyeux…
Dès qu’il fut entré au Paradis, deux secondes, montre en main, ne s’étaient pas écoulées
(bien que sa montre, à mon avis, ait dû se décomposer en ses éléments durant le voyage)
et il s’écriait déjà que, pour ces deux secondes, on pouvait faire non seulement un quatrillion de kilomètres,
mais un quatrillion de quatrillions, à la quatrillionième puissance !
Bref, il chanta Hosanna, il exagéra même,
au point que des penseurs plus dignes refusèrent de lui tendre la main les premiers temps;
il était devenu trop brusquement conservateur. C’est le tempérament russe.
Je te le répète, c’est une légende. Voilà les idées qui ont cours chez nous sur ces matières [10].
~*******~
Blackout.
Des flashs stroboscopiques éblouirent Aristide.
Il voulut se protéger les yeux. Inutile : les flashs semblaient venir tout droit depuis son cerveau.
Une crise d'épilepsie ? Non. Ce n'était pas ça. Il recula. Pour essayer de recouvrer ses esprits.
Autour de lui, la scène était macabre.
Et le pire est qu'il la voyait désormais en noir et blanc, comme dans un vieux film, entrecoupée d'inexplicables éclairs.
Des ombres trop nombreuses pour qu'on puisse les discerner s'étaient levés de toute la salle.
Combien étaient-ils ? Impossible de le dire. Les regards étaient braqués sur lui. Mais les yeux étaient inhumains,
la pupille noire minuscule et l'iris jaune-vert. Les fronts méchamment plissés. Les canines proéminentes.
Les invités au festin - et l'on ne saurait désormais ignorer qui fait figure de festin - n'avaient plus aucune figure humaine.
L'
Idiot s'était levé, lui aussi, mais sa physionomie avait elle aussi perdue toute humanité.
Il saisit notre héros droit à la gorge. La main griffue de l'
oupyr, gigantesque, autour de son cou, serrait de plus en plus fort.
De petites veines lézardait le blanc de ses yeux. Sa thyroïde se gonflait. Les artères carotides devenaient visibles.
Son visage s'empourprait. Dans un sourire de vampire, le psychologue siffla :
'On a les Socrate qu'on mérite.' [11]
Il nourrissait de bien sombres pensées : Et si, finalement, Celimbrimbor était à l'origine de tout ça ?
Et si son ami lui avait tendu un piège !? Un piège mortel.
Sa vie ne pouvait être plus désespérée et sa mort ne lui était jamais apparue si proche.
Dehors, dans la nuit glaciale, un premier flocon de neige tombait lentement.
Un flocon que l'on étreint sans un bruit, pour le voir mourir, doucement, au creux de la main.
Comme des larmes que l'on écrit à l'encre salée sur la neige mouillée.
Un hiver
à la russe. Un hiver sans fin.
(
https://www.youtube.com/watch?v=BnDY4jC7JZM).
Fin de l'épisode 2
Takatsuki Sen,
psycho writer.
Merci de m'avoir lu.
Toutes ressemblances avec des personnages existants n'est ni fortuite ni involontaire (sourire).
.
.
.
~ Epilogue ~
La Perspective
New Sky [12]. Air pur, ciel azur.
Allongée dans l'herbe, les mains croisées derrière la tête, à quoi pouvait-elle songer ?
"La couleur bleue n'est pas dans les cieux mais dans les yeux [13] ... A quoi bon voyager ?
Si on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière, alors autant rester au même endroit."
Délicatement les mains se décroisent pour se laisser effleurer par les herbes et les fleurs.
Le corps en croix, la martyre
postmodern ferme les yeux.
"Famille. Amitié. Amour. Valeurs. Société. Qu'est-ce que tout cela ?
Bonheur. Argent. Souffrances. Sentiments. Je ne comprends rien.
Foutue pour foutue, on ne jouit que de ce qu'on a perdu."
Eclats de rire.
Puis, des larmes coulent sur les joues rosies par la fraîcheur du petit matin.
La brume jette un voile de mélancolie sur le Soleil qui aurait tant voulu hurler sa joie de vivre pour les Terriens.
"La vie est un théâtre, une grande dérision. La musique est si furtive : du plus subtil de nos arts, il ne restera rien.
Nous sommes les ombres d'une Ombre, de quoi vivra-t-on après nous ?"
~ Annexes ~
The eagle never lost so much time as when he submitted to learn of the crow.
~ William Blake[1] Veut-on caractériser extérieurement le génie ?
Considérez les portraits d'Edgar Allan Poe, de Baudelaire, de Schopenhauer.
De Napoléon.
"
Presque tous ceux que j’ai vus de lui sont des caricatures. Beaucoup de peintres lui ont donné les yeux inspirés
d’un poète. Ces yeux-là ne vont pas avec l’étonnante capacité d’attention qui est le caractère de son génie.
Il me semble que ces yeux expriment un homme qui vient de perdre ses idées ou un homme qui vient d’avoir la vue
d’une image sublime. Sa figure était belle, quelquefois sublime, mais c’était parce qu’elle était tranquille.
Ses yeux seuls avaient des mouvements rapides et beaucoup de vivacité. Il souriait souvent, ne riait jamais.
Je l’ai vu une seule fois transporté de plaisir : ce fut après avoir entendu Crescentini chanter l’air "Ombra adorata aspetia".
Les moins mauvais portraits sont de Robert Lefèvre et de Chaudet, les plus mauvais de David et de Canova."
Stendhal,
Vie de Napoléon.
A l'instant où l'auteure écrit ces lignes, elle pense à l'un de ses chats, attiré par un bruit à l'étage,
dont l'expression du regard prend en un instant tous les signes de l'attention profonde.
Ce regard est bien différent de celui quand il joue avec un jouet.
[2] Cette pensée de Celimbrimbor, selon laquelle le "surhumain", se traduit le mieux, dans la pensée nietzschéenne,
à travers le couple Apollon/ Dionysos n'est pas de Nietzsche. Elle est de Wagner. Qui avait lu Schopenhauer.
"
Toute oeuvre d'art tend donc, à vrai dire, à nous montrer la vie et les choses telles qu'elles sont dans leur réalité,
mais telles aussi que chacun ne peut les saisir immédiatement à travers le voile des accidents objectifs et subjectifs.
C'est ce voile que l'art déchire."
Schopenhauer dans ses Suppléments au 3ème livre, chap. 34
On peut cependant aisément pardonner à celui dont la lecture de Nietzsche se limite à son premier
l'Origine de la Tragédie (1872) et à son dernier 'grand écrit'
le Crépuscule des Idoles (1888).
Mais ferons-nous preuve d'une telle indulgence pour les lettrés français ?
Nietzsche n'était pas un philosophe. N'est-ce pas une erreur fort grossière de le ranger, comme le font nos intellectuels,
dans la continuité de Kant et de Schopenhauer ?
Déjà, en 1872, il écrivait : "
L'art est plus puissant que la connaissance, car il veut la vie,
tandis que le but ultime qu'atteint la connaissance n'est que — l'anéantissement. —"Hors compositions musicales, il n'est pas si évident de trouver des textes traduits de Wagner.
Cependant, en cherchant un peu, on trouve du Wagner cité par... Baudelaire :
Dans cette même
Lettre sur la musique (...) nous trouvons une préoccupation très vive du théâtre grec (...) :
(ici commence la citation de Wagner) J'y rencontrai tout d'abord l'œuvre artistique par excellence, le drame (...)
Ceci me conduisit à étudier les rapports des diverses branches de l'art entre elles, et, après avoir saisi la relation
qui existe entre
la plastique et
la mimique, j'examinai celle qui se trouve entre la musique et la poésie (...)
Je reconnus, en effet, que précisément là où l'un de ces arts atteignait à des limites infranchissables, commençait aussitôt,
avec la plus rigoureuse exactitude, la sphère d'action de l'autre; que, conséquemment, par l'union intime de ces deux arts,
on exprimerait avec la clarté la plus satisfaisante ce que ne pouvait exprimer chacun d'eux isolément; que, par contraire,
toute tentative de rendre avec les moyens de l'un d'eux ce qui ne saurait être rendu que par les deux ensemble,
devait fatalement conduire à l'obscurité, à la confusion d'abord, et ensuite,
à la dégénérescence et à la corruption de chaque art en particulier."
L'art romantique - Wagner & Tannhäuser à Paris (1861).
Derrière les termes ampoulés de
plastique et de
mimique,
ne reconnaît-on pas ce que Nietzsche entend par Apollon et Dionysos, cependant en termes moins équivoques ?
[3] La volonté de puissance (
der Wille zur Macht auslassen),
que l'on pourrait penser comme volonté
en puissance, c'est-à-dire
potentielle;
par opposition à une volonté
en acte, réelle, qui agit.
Cette idée est permise si la volonté, au sens où Schopenhauer l'entendait, n'agit pas, n'entre pas dans la causalité.
N'appartenant pas au phénomène ou à la représentation. D'où la volonté est la chose en soi.
On pourrait encore traduire ce terme par volonté
en regard de la puissance,
Cette traduction nous semble plus appropriée à ce que voulait en dire Nietzsche.
La troisième dissertation de la
Généalogie de la morale, traite de l'idéal ascétique,
et, au p.27, fait mention d'un projet d'une
Volonté de Puissance. Un essai sur une inversion de toutes les valeurs.
L'auteur, philologue et historien de la philosophie, y traiterait de l'histoire du nihilisme européen,
et plus particulièrement du sens de l'idéal ascétique : la volonté de puissance prenant la forme de cet idéal.
Nous attirons surtout l'attention sur le terme 'essai' : par conséquent, bien moins une nouvelle doctrine qu'une simple critique.
Mais avait-il mieux à nous proposer que la
Critique de la raison pure de Kant, qui coupait dans leurs racines :
le matérialisme, le fatalisme, l'athéisme, l'incrédulité des libres penseurs, le fanatisme, la superstition, l'idéalisme, le scepticisme ?
Notre opinion à ce sujet est que Nietzsche s'est amusé à lier une notion physiologique basée sur la téléologie de Kant
à une généalogie des mœurs, tantôt 'morale aristocratique' (maîtres), tantôt 'morale du ressentiment' (esclaves).
La volonté de puissance devenant idéal ascétique appartenant à cette dernière.
Pour rappel, voici ce que dit Kant : un produit organisé de la nature est celui dans lequel tout est fin et réciproquement aussi moyen.
Il n'y a rien en lui qui soit rien pour rien, sans fin, ou qui se doive attribuer à un mécanisme aveugle de la nature.
En revanche, tout au contraire de notre interprétation, Michel Onfray,
dans son gros livre intitulé
La construction du surhomme (tome 7, 2011. 20,90€ -Lu à la médiathèque-), nous explique ceci,
à la page 188 :
"Dès lors la psychologie nietzschéenne, autrement dit son herméneutique, s'avance telle une 'morphologie
et (une) théorie générale de la volonté de puissance (paragraphe 23 ).
Voilà le maître concept lâché :
volonté de puissance - plus judicieusement traduit par volonté
vers la puissance,
le
zur de
Wille zur Macht, étant plus justement rendu de la sorte,
ce qui présente également l'avantage de rendre fautive la lecture de cette expression
comme volonté d'exercer sa puissance sur autrui, comme de tant de mésinterprétations de la pensée de Nietzsche."
Le paragraphe 23 en question : "Toute la psychologie s’est arrêtée jusqu’à présent à des préjugés et à des craintes morales :
elle n’a pas osé s’aventurer dans les profondeurs.
Oser considérer la psychologie comme morphologie et comme
doctrine de l’évolution dans la volonté de puissance,
ainsi que je la considère — personne n’y a encore songé, même de loin : autant, bien entendu,
qu’il est permis de voir dans ce qui a été écrit jusqu’à présent un symptôme de ce qui a été passé sous silence.
La puissance des préjugés moraux a pénétré profondément dans le monde le plus intellectuel, le plus froid en apparence,
le plus dépourvu d’hypothèses — et, comme il va de soi, cette influence a eu les effets les plus nuisibles,
car elle l’a entravé et dénaturé." (
Par delà Bien et Mal)
Et, plus loin, Onfray affirme encore, page 274 :
"On peut donc formuler une équivalence entre
volonté de puissance et
volonté de vie,
mais aussi entre
volonté de puissance et
toute énergie agissante et entre
monde réel,
autrement dit monde vrai, le seul, et
volonté de puissance (...) Rien à voir avec le vouloir vivre de Schopenhauer,
car ce qui n'est pas ne peut vouloir la vie, Nietzsche renvoie donc Schopenhauer à l'idéalisme,
à la métaphysique platonicienne. Lui ne pense pas à cette forme en terme d'idée mais de réalité :
elle est l'équivalent du
nisus chez d'Holbach ou Guyau - sinon chez les médecins qui philosophent."
"Les atomes épicuriens tiennent la place de la volonté de puissance nietzschéenne : la physique évacue la métaphysique,
la science détruit la théologie." (p. 278)
"On pourrait donc établir une équivalence qui donnerait la formule de l'hédonisme vitaliste de Nietzsche :
une volonté de jouissance accompagne toujours la volonté de puissance." (p.292)
Nous aimerions beaucoup qu'Onfray explique ces passages qui nous éclairent au moins sur un point :
il n'a lu ni Kant ni Schopenhauer. Et si malgré tout il prétend le contraire, alors c'est qu'il n'a compris ni l'un ni l'autre.
Proposons-lui simplement de se référer au paragraphe 22 du
MVR de Schopenhauer :
"Jusqu’ici on a fait rentrer le concept de volonté sous le concept de force; c’est tout le contraire que je vais faire,
et je considère toute force de la nature comme une volonté.
Que l’on ne croie pas que ce n’est là qu’une discussion de mots, une discussion oiseuse : elle est, au contraire,
de la plus haute signification et de la plus grande importance.
Car, en dernière analyse, c’est la connaissance intuitive du monde objectif, c’est-à-dire le phénomène, la représentation,
qui est à la base du concept de force; c’est de là qu’il est tiré.
Il vient de ce domaine où règnent la cause et l’effet, c’est-à-dire de la représentation intuitive, et signifie l’essence du motif,
au point où l’explication étiologique n’est plus possible, mais où se trouve la donnée préalable à toute explication étiologique.
Au contraire, le concept de volonté est le seul, parmi tous les concepts possibles, qui n’ait pas son origine dans le phénomène,
dans une simple représentation intuitive, mais vienne du fond même, de la conscience immédiate de l’individu,
dans laquelle il se reconnaisse lui-même, dans son essence, immédiatement, sans aucune forme, même celle du sujet et de l’objet,
attendu qu’ici le connaissant et le connu coïncident. Ramenons maintenant le concept de force au concept de volonté :
c’est en réalité ramener un inconnu à quelque chose d’infiniment plus connu, que dis-je ?
à la seule chose que nous connaissions immédiatement et absolument; c’est élargir considérablement notre connaissance.
Si nous faisons rentrer, au contraire, — comme on l’a fait jusqu’ici, — le concept de volonté sous le concept de force,
nous nous dépouillons de l’unique connaissance immédiate que nous ayons de l’essence même du monde,
en la noyant dans un concept abstrait tiré de l’expérience, et qui, par conséquent, ne nous permettra jamais de la dépasser."[4] Cette théorie, mise au goût du jour par une poignée d'érudits au XIXème,
n'a cependant toujours pas trouvé au XXIème de réponse satisfaisante.
L'auteure trouvait piquant d'opposer Aristide à la version
dark de Dostoïevski, un des auteurs qu'il affectionne.
Shakespeare, qui avait tant besoin de se fuir lui-même à travers la peinture des caractères les plus passionnés ...
"
Je ne connais pas de lecture qui déchire le cœur autant que Shakespeare :
combien un homme a dû souffrir pour avoir, à ce point, besoin de faire le pitre ! — Comprend-on Hamlet ?
Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou. Mais pour sentir ainsi, il faut être profond, il faut être philosophe,
il faut avoir un abîme en soi... Nous avons tous peur de la vérité... Et, que je fasse ici un aveu,
je suis instinctivement certain que Lord Bacon est le créateur, le tortionnaire de cette sorte de littérature,
la plus inquiétante qui soit. Que m’importe le pitoyable bavardage de ces esprits américains plats et confus.
La prodigieuse puissance dans la réalité des visions est non seulement compatible avec la puissance de l’action, du crime,
elle en est même le corollaire... Nous sommes loin d’en savoir assez sur Lord Bacon, ce premier réaliste,
au sens le plus vaste du mot, pour savoir tout ce qu’il a fait, tout ce qu’il a voulu, tout ce qu’il a vécu avec lui-même...
Allez donc au diable, messieurs les critiques !"
Ecce Homo, Pourquoi je suis si avisé (paragraphe III)Au moment de sa folie, Nietzsche y revient dans l'un de ses billets daté du 3 janvier 1889, adressé à Cosima Wagner.
Bacon de Verulam, philosophe, empiriste, expérimentateur qui nous semble un "Léonard de Vinci du Nord",
"Le plus habile, le plus éclairé et le plus faillible des hommes" (Pope), arriviste et carriériste abject,
tombé en disgrâce et enfermé à la Tour de Londres... Et auteur des tragédies de Shakespeare !
Quel sujet pour les blockbusters américains si avides de biographies ! Allons, courage.
[5] Nietzsche, psychologue. C'est ainsi qu'il s'autoproclame ouvertement.
Mais encore faut-il savoir ce qu'il entend par 'psychologue'.
La réponse nous en est donnée par un certain Paul Bourget,
auteur français qui n'a sans doute pas joui de la même renommée que Nietzsche,
et disciple de l'historien Hippolyte Taine (comme Nietzsche l'était de Jacob Burckhardt).
Dans ses
Essais de psychologie contemporaine, c'est le moment où il brosse le portrait de Stendhal :
"
D'ordinaire nous nous déplaçons pour être ailleurs, parce que la monotonie de nos habitudes nous lassent.
Nous espérons rajeunir nos sensations,
en abandonnant pour quelques semaines ou quelques mois un milieu qui ne nous suggère plus ni plaisirs aigus ni peines attachantes.
Nous mettons notre existence de chaque jour en jachère, pour la retrouver plus féconde au retour.
Ou bien nous avons étudié par avance un pays et nous désirons passer de la lettre écrite au fait direct.
Nous voulons éprouver le livre par la vie, doubler notre érudition de seconde main par des constatations immédiates.
La première de ces deux méthodes de voyage est celle des oisifs, la seconde est celle des savants :
historiens ou critiques d'art, érivains ou simples amateurs. Il en est une troisième, qui est proprement celle du psychologue.
Elle est difficile à pratiquer, car elle suppose la faculté, si rare, de s'inventer des plaisirs et la faculté, plus rare encore,
d'interpréter ces plaisirs. Elle consiste à soumettre sa personne à la pression d'un pays nouveau,
comme un chimiste soumet un corps à la pression d'une température nouvelle,
en observant avec une entière absence de parti pris les petites jouissances et les petites souffrances que cette nouveauté emporte avec elle ..."
Dans le
Crépuscule des Idoles (
Loisirs d'un psychologue avant que Nietzsche n'en change le titre) :
"
Pour le problème (le criminel et ses analogues) qui se présente ici, le témoignage de Dostoïevsky est d’importance
— de Dostoïevsky le seul psychologue dont, soit dit en passant, j’ai eu quelque chose à apprendre;
il fait partie des hasards les plus heureux de ma vie, plus même que la découverte de Stendhal.
Cet homme profond, qui a eu dix fois raison de faire peu de cas de ce peuple superficiel que sont les Allemands,
a vécu longtemps parmi les forçats de Sibérie, et il a reçu de ces vrais criminels,
pour lesquels il n’y avait pas de retour possible dans la société,
une impression toute différente de celle qu’il attendait;
— ils lui sont apparus taillés dans le meilleur bois que porte peut-être la terre russe,
dans le bois le plus dur et le plus précieux."
Cette considération du
criminel type comme un 'surhomme' se retrouve aussi chez le médecin Cesare Lombroso.
[6] Traduirons-nous par
Der Übermensch (le surhomme) ?
D'autres interprétations sont-elles envisageables ?
Lorsqu'on avance une hypothèse sur un auteur, il importe de bien connaître son sujet :
lire ses écrits, étudier ses contemporains, le comprendre.
Après des années passées à étudier gratuitement le
Cas Nietzsche, sans y être jamais forcée par son métier,
par obligation morale, ou encore pour 'valider une thèse', l'auteure se propose ici de résoudre le problème du "surhumain"
qui a autant été agité par une partie de l'intelligentsia européenne que négligé par l'autre.
La méthode, de rigueur, consistait à effectuer une
analyse bibliographique,
et, à partir de là, à réagir par une intuition digne de
Coucou-les-nuages à partir des données acquises.
Nous ne rappelons ceci que pour informer nos Lecteurs moins prévenus comment procèdent ces tâcherons qu'ils portent aux nues.
Que la postérité nous pardonne de l'entretenir de gens insignifiants.
Qu'on ne s'étonne donc pas de voir figurer à la première page d'une thèse ou d'un livre, tant de remerciements si pompeux :
pour cette sorte de gens, les critiques ne sont jamais rien d'autres que des lettres de change.
Pour seul exemple de cette
plebis species, nous citerons le franchouillard Michel Onfray,
dont l'ouvrage
La construction du surhomme est une sommité de mésinterprétations.
On ne saurait se montrer moins objectifs que nos soi-disant philosophes,
qui ne savent faire que l'histoire de la philosophie au lieu d'une vraie philosophie dont la voie leur avait pourtant été montrée par Kant.
Permettons-nous encore ici une observation toute personnelle : une des causes de ce que la philosophie (critique métaphysique)
devient philologie (critique historique), est à rechercher dans cette séparation entre les étudiants en sciences d'un côté, en lettres de l'autre.
Pour nous, comme pour Schopenhauer, cette séparation est non avenue.
Quand on voit des Nietzsche, des Houellebecq ou des Onfray, ou tout prétendu philosophe,
appuyer leurs idées sur les dernières découvertes à la mode,
on peut se rassurer en se disant que leurs ouvrages serviront comme allume-feux pour l'hiver,
et cela sans attendre un hypothétique cataclysme (
https://www.youtube.com/watch?v=nucU0V44zUY).
Nous n'isolerons pas l'auteur de son siècle, ni le terme de son texte, comme des êtres à part, des
causa sui;
et contrairement à ceux qui se sont focalisés sur ce sujet, nous mettrons un véritable point d'honneur
à
détruire toutes les contradictions qui peuvent entacher les pensées de l'auteur.
Ce qui nous a surtout confirmé dans nos vues, c'est que le terme s'est toujours trouvé en accord avec nos hypothèses.
Mais reprenons notre étude. Elle se divisera en trois parties :
- le surhumain de Nietzsche ,
- le surhumain d'Onfray ,
- le surhumain de l'auteure.
- le surhumain de Nietzsche -
"
Par de telles transformations, beaucoup d’hypocrisie et de mensonge s’est chaque fois introduit dans le monde :
chaque fois aussi, et à ce prix seulement, une conception surhumaine qui élève l’homme."
Aurore (1881) Livre I, 27 : La valeur dans la croyance aux passions surhumaines.
"
Si l’on considère tout ce qui a été vénéré jusqu’à présent sous le nom d’ 'esprit surhumain', de 'génie',
on arrive à la triste conclusion que, dans son ensemble, l’intellectualité humaine a dû être quelque chose de très bas et de très pauvre :
tant il fallut peu d’esprit pour se sentir considérablement supérieur à elle ! Qu’est-ce que la gloire facile du 'génie' ?
Son trône est si vite atteint ! son adoration est devenue un usage ! (…)"
Aurore (1881) Livre V, 548 : La victoire sur la force.
"
La foi en des esprits grands, supérieurs, féconds, est, non pas nécessairement, mais très souvent,
encore unie à cette superstition entièrement ou à demi religieuse, que ces esprits seraient d’origine surhumaine
et posséderaient certaines facultés merveilleuses, au moyen desquelles ils acquerraient leurs connaissances
par une tout autre voie que le reste des hommes."
Humain, trop humain I (1878-1880), De l'âme des artistes et des écrivains.
164 : Danger et avantage du culte du génie.
"
Le soulèvement des paysans dans le domaine de l'esprit.
(...) C'est justement là que la croyance populaire en quelque chose de surhumain dans l'homme,
au miracle, au Dieu sauveur dans l'homme, a son mandataire le plus subtil et le plus insidieux."
Le gai savoir (1882), 358.
"
Tranquillement une erreur après l’autre est posée sur la glace; l’idéal n’est pas réfuté, — il est congelé.
— Ici, par exemple, c’est "le génie" qui gèle; tournez le coin et vous verrez geler "le saint"
sous une épaisse chandelle de glace, gèle "le héros"; pour finir c’est "la foi", ce qu’on appelle "la conviction" qui gèle,
"la pitié" aussi se réfrigère considérablement, — presque partout gèle la "chose en soi"...Ecce Homo (1888), Pourquoi j'écris de si bons livres.
'Surhumain' est ici un qualificatif : le saint est surhumain dans sa bonté, le génie est surhumain dans sa productivité.
Le surhumain est la métaphore d'une idée (au sens platonicien) qui exhausse l'Homme.
Il n'est donc ni l'un ni l'autre, ainsi que le croyait Phil1403, dans cet échange avec Celimbrimbor du 10 Octobre 2015 :
phil1403 a écrit:
(...)En passant, toujours sur Nietzsche,
on traduit toujours über par sur-homme, alors qu'il faudrait plutôt entendre par dessus au sens de sauter à cloche pied,
au dessus du pli du tapis... plutôt que de s'y prendre les pieds. bref, dans le sens, d'une capacité à passer outre...
peut-être aussi au sens d'une forme de maitrise de soi (vs contrôle).
donc le sur-humain, plutôt qu'un homme dominateur, est plutôt la capacité à accueiiir cette part d'abîme en soi,
cad notre humanité, ses limites et sa finitude, avec sang froid et compassion (je tente le mot

),
cad à développer aussi la capacité à l'incorporer à son quotidien sans se prendre, encore une fois, les pieds dans le tapis
(voir la figure du funambule qui a peur de son ombre et qui chute).
Bref, quelque part, on est plus proche du saint qu'autre chose.
Mais bon, ce mot n'était certainement pas du goût de Nietzsche dont le père était pasteur si je me souviens bien.
...
Ne serait-ce pas limiter considérablement le terme 'surhumain' d'en faire un simple qualificatif relatif et rien d'autre ?
"
De tous les moyens d’exaltations, ce sont les sacrifices humains qui, de tous temps,
ont le plus élevé et spiritualisé l’Homme. Et peut-être y a-t-il une seule idée prodigieuse qui, maintenant encore,
pourrait anéantir toute autre aspiration, en sorte qu’elle remporterait la victoire sur le plus victorieux,
— je veux dire l’idée de l’humanité qui se sacrifie. Mais à qui devrait-elle se sacrifier ?
On peut déjà jurer que, si jamais la constellation de cette idée apparaît à l’horizon,
la connaissance de la vérité demeurera le seul but énorme à quoi un pareil sacrifice serait proportionné,
parce que pour la connaissance aucun sacrifice n’est trop grand. En attendant le problème n’a jamais été posé,
on ne s’est jamais demandé en quel sens sont possibles des démarches pour encourager l’humanité dans son ensemble;
et moins encore quel serait l’instinct de connaissance qui pousserait l’humanité à s’offrir elle-même en holocauste
pour mourir avec dans les yeux la lumière d’une sagesse anticipée."
Aurore (1881), paragraphe 45 du Livre I
Comparez la signification
métaphysique de ce texte avec celui-ci, rédigé 7 ans plus tôt :
"
De fait, il est grandement temps d’entrer en campagne, avec le ban et l’arrière-ban des méchancetés satiriques,
contre les débauches du sens historique, contre le goût excessif pour le processus, au détriment de l’être et de la vie,
contre le déplacement insensé de toutes les perspectives.
Et, il faut le dire à la louange de l’auteur de la Philosophie de l’inconscient,
il a réussi à sentir violemment ce qu’il y a de ridicule dans la conception du « processus universel »
et à le faire sentir plus violemment encore par le sérieux particulier de son exposition.
À quoi sert le "monde", à quoi sert l’ "humanité" ? Cela ne doit provisoirement pas nous préoccuper,
à moins que nous ne voulions nous amuser d’une petite plaisanterie;
car la présomption des petits reptiles humains est ce qu’il y a de plus drôle et de plus joyeux sur le théâtre de la vie.
Mais à quoi tu sers, toi, l’individu! demande-le-toi, et si personne d’autre ne peut te le dire,
essaye donc de justifier le sens de ton existence, en quelque sorte a posteriori, en t’imposant à toi-même un but,
un "service" supérieur et noble. Que ce service te fasse périr ! (...)
Non, le but de l’humanité ne peut pas être au bout de ses destinées,
il ne peut s’atteindre que dans ses types les plus élevés.(...)
Et comment arrivons-nous à ce but ? Me demanderez-vous.
Le dieu delphique vous jette, dès le début de votre voyage vers ce but, sa sentence : « Connais-toi toi-même ! »
C’est une douce sentence, car ce dieu « ne cache point et ne proclame point, mais ne fait qu’indiquer »,
comme a dit Héraclite. Où donc vous conduit-il ?"
De l'utilité et des inconvénients de l'histoire pour la vie (1874)
Ces textes montrent clairement ce qui a le plus échappé aux modernes, transhumanistes en herbe :
l'idée du surhumain est en opposition totale avec l'idée d'un processus universel.Et encore dans l'
Antéchrist, aux paragraphes 3, 4 et 5 :
"
Je ne pose pas ici ce problème :
Qu’est-ce qui doit remplacer l’humanité dans l’échelle des êtres (— l’homme est une fin —) ?
Mais : Quel type d’homme doit-on élever, doit-on vouloir, quel type aura la plus grande valeur, sera le plus digne de vivre,
le plus certain d’un avenir ?
Ce type de valeur supérieure s’est déjà vu fréquemment : mais comme un hasard, une exception, jamais comme type voulu.
Au contraire, c’est lui qu’on a le plus craint ; jusqu’à présent il fut presque le redoutable ;
— et cette crainte engendra le type contraire, voulu, dressé, atteint : la bête domestique, la bête du troupeau,
la bête malade qu’est l’homme, — le chrétien… "
"
L’humanité ne représente pas un développement vers le mieux, vers le plus fort, vers le plus haut,
de la manière dont on le pense aujourd’hui. Le « progrès » n’est qu’une idée moderne, c’est-à-dire une idée fausse.
Dans sa valeur l’Européen d’aujourd’hui reste bien loin au-dessous de l’Européen de la Renaissance.
Se développer ne signifie absolument pas nécessairement s’élever, se surhausser, se fortifier.
Dans un autre sens il existe une continuelle réussite de cas isolés, sur différents points de la terre,
au milieu des civilisations les plus différentes. Ces cas permettent, en effet, de créer un type supérieur, quelque chose qui,
par rapport à l’humanité tout entière, constitue une espèce d’hommes surhumains. De tels coups de hasard de la grande réussite,
furent toujours possibles et le seront peut-être toujours. Et même des races tout entières, des tribus, des peuples peuvent,
dans des circonstances particulières, représenter de pareils 'billets noirs'."
"
Il ne faut vouloir ni enjoliver ni excuser le christianisme : Il a mené une guerre à mort contre ce type supérieur de l’homme,
il a mis au ban tous les instincts fondamentaux de ce type, il a distille de ces instincts le mal, le méchant :
l’homme fort, type du réprouvé. Le christianisme a pris parti pour tout ce qui est faible, bas, manqué,
il a fait un idéal de l’opposition envers les instincts de conservation de la vie forte,
il a gâté même la raison des natures les plus intellectuellement fortes en enseignant que les valeurs supérieures
de l’intellectualité ne sont que péchés, égarements et tentations. Le plus lamentable exemple, c’est la corruption de Pascal
qui croyait à la perversion de sa raison par le péché original, tandis qu’elle n’était pervertie que par son christianisme ! "
Enfin, pour ne pas être en reste sur Nietzsche lui-même, qui, de 1874 à 1888, n'a jamais écrit que les mêmes choses,
le philosophe est 'surhumain' dans son retournement des valeurs.
C'est ainsi qu'il faut comprendre Schopenhauer 'éducateur' pour ce poète médiocre,
jésuite et musicien du clair de Lune raté et suicidaire.
Comment donc Nietzsche pourrait-il être un disciple affranchi de la philosophie pessimiste de Schopenhauer,
comme l'affirment tous ceux qui l'ont 'étudié' ?
Ceux qui se prétendent les continuateurs de Schopenhauer : Hartmann, Mainländer et Bahnsen sont fort médiocres
et n'apportent rien d'original sur le maître.
Ce serait commettre un contresens d'affirmer : le surhumain est un idéal en soi.
Car, le problème de Nietzsche, c'est justement que la morale considère les choses
en soi.
Nietzsche est un philologue, un historien, un généalogiste : son antipode est Kant, le métaphysicien, pour qui l'Homme, dans son essence ne varie pas.
Le terme 'surhumain' est donc une invitation à s'interroger sur le sens ascétique de notre morale,
par opposition à un sens aristocratique, celui d'une autre morale, qui a été surmontée. C'est ce point qu'il convient de préciser.
"
(...)Un autre idéal court devant nous, un idéal singulier, tentateur, plein de dangers,
un idéal que nous ne voudrions recommander à personne,
parce qu'à personne nous ne reconnaissons facilement le droit à cet idéal :
c'est l'idéal d'un esprit qui se joue naïvement, c'est-à-dire sans intention,
et parce que sa plénitude et sa puissance débordent, de tout ce qui jusqu'à présent s'est appelé sacré, bon, intangible, divin;
pour qui les choses les plus hautes qui servent, avec raison, de mesure au peuple,
signifieraient déjà quelque chose qui ressemble au danger, à la décomposition,
à l'abaissement ou bien du moins à la convalescence, à l'aveuglement, à l'oubli momentané de soi;
c'est l'idéal d'un bien-être et d'une bienveillance [à la fois humain et surhumain],
un idéal qui apparaîtra souvent inhumain,
par exemple lorsqu'il se place à côté de tout ce qui jusqu'à présent a été sérieux, terrestre,
à côté de toute espèce de solennité dans l'attitude, la parole, l'intonation, le regard, la morale,
comme leur vivante parodie involontaire - et avec lequel, malgré tout cela,
le grand sérieux commence peut-être seulement, le véritable problème est peut-être seulement posé,
la destinée de l'âme se retourne, l'aiguille marche, la tragédie commence..."
Le Gai Savoir (1882)[/u], 382. La grande santé.
"
Sur l’antagonisme entre la 'morale noble' et la 'morale chrétienne', ma Généalogie de la Morale
donne les premiers enseignements : il n’y a peut-être pas de revirement plus décisif
dans l’histoire de la connaissance religieuse et morale. Ce livre, qui me sert de pierre de touche à l’égard de mes pairs,
a le bonheur de n’être accessible qu’aux esprits les plus élevés et les plus sévères; les autres manquent d’oreilles pour m’entendre.
Il faut mettre sa passion dans des choses où personne ne la met aujourd’hui…"
Le Cas Wagner (1888), note de Nietzsche.
Pour comprendre où Nietzsche veut en venir,
il est donc impératif d'avoir à l'esprit l'opposition entre une 'morale de maîtres' et une 'morale d'esclaves'.
Il est impératif aussi, mais à la stricte condition d'être honnête, de se réclamer de Nietzsche en faisant sienne cette question :
"Quel est exactement, au point de vue étymologique, le sens des désignations du mot 'bon' dans les diverses langues ?
C’est alors que je découvris qu’elles dérivent toutes d’une même transformation d’idées,
— que partout l’idée de 'distinction', de 'noblesse', au sens du rang social,
est l’idée mère d’où naît et se développe nécessairement l’idée de 'bon' au sens 'distingué quant à l’âme',
et celle de 'noble', au sens de 'ayant une âme d’essence supérieure', 'privilégié quant à l’âme'." Généalogie de la morale (1887), 1ère dissertation.
Mais c'est ce qu'un Michel Onfray ne se rabaisse même pas à faire, lui dont pas une ligne de son gros ouvrage,
n'est consacrée à cette opposition ni à une étymologie, pourtant si importantes pour notre compréhension.
Comme une dernière indication de l'autre voie apparut Napoléon,
homme unique et tardif si jamais il en fut, et par lui le problème incarné de l'idéal noble par excellence —
qu'on réfléchisse bien au problème : Napoléon, cette synthèse de l'inhumain et du surhumain !...Avant tout on a voulu me faire comprendre 'l’indéniable supériorité' de notre temps en matière d’opinion morale,
notre véritable progrès sur ce domaine : impossible d’accepter qu’un César Borgia, comparé avec nous, puisse être présenté,
ainsi que je l’ai fait, comme un 'homme supérieur', comme une espèce de surhumain…Napoléon et César Borgia, considérés du point de vue de la 'morale des esclaves' incarnent le méchant typique.
C'est aussi de la sorte que Nietzsche caractérise la Renaissance, période indifférente pour le mal qui étouffait le Moyen Age.
Le mot 'surhumain', par exemple, qui désigne un type de perfection absolue, en opposition avec l’homme 'moderne', l’homme 'bon',
avec les chrétiens et autres nihilistes, lorsqu’il se trouve dans la bouche d’un Zarathoustra, le destructeur de la morale,
prend un sens qui donne beaucoup à réfléchir.
Presque partout, en toute innocence, on lui a donné une signification qui le met en contradiction absolue avec les valeurs
affirmées par le personnage de Zarathoustra, je veux dire qu’on en a fait le type 'idéaliste' d’une espèce supérieure d’hommes,
à moitié 'saint', à moitié 'génie'...
D’autres bêtes à cornes savantes, à cause de ce mot, m’ont suspecté de darwinisme;
on a même voulu y retrouver le "culte des héros" de ce grand faux monnayeur inconscient qu’était Carlyle,
ce culte que j’ai si malicieusement rejeté.
Quand je soufflais à quelqu’un qu’il ferait mieux de s’enquérir d’un César Borgia que d’un Parsifal,
il n’en croyait pas ses oreilles.
(...)
un idéal de bien-être et de bienveillance humainement surhumains qui paraîtra facilement inhumain quand,
par exemple, prenant place à côté de tout ce sérieux qu'on a révéré ici,
à côté de toute la solennité qui a régné jusqu'à ce jour dans le geste, le verbe, le ton, le regard, la morale et le devoir,
il se révélera involontairement comme leur parodie incarnée;
lui qui pourtant est appelé peut-être à inaugurer l'ère du grand sérieux,
à poser le premier à sa place le grand point d'interrogation, à changer le destin de l'âme, à faire avancer l'aiguille,
à lever le rideau de la tragédie...
(...)
Et comme il sait descendre vers chacun, lui parler avec bienveillance !
Avec quelle délicatesse il touche aux prêtres, ses adversaires, comme il souffre d'eux avec eux !
A tout moment il dépasse l'homme, le 'surhumain' incarne en lui sa suprême réalité;
tout ce qu'on avait appelé grand chez l'homme jusqu'ici gît à des abîmes au-dessous de lui.
L' alcyonisme de Zarathoustra, ses pieds légers, l'omniprésence de sa méchanceté et de son impétuosité,
rien de tout ce qui le caractérise n'avait jamais été considéré, même par les plus audacieux,
comme un attribut essentiel de la grandeur.
(...)
il ne cache pas que son type d'homme, type relativement surhumain,
est surhumain précisément par rapport aux hommes bons,
et que les bons et les justes appelleraient son surhomme 'démon'...
« Hommes supérieurs que rencontre mon oeil voici la cause de mon doute et la raison de mon rire secret;
j'ai deviné que vous appelleriez 'Démon' mon Surhomme.
Votre âme est tellement étrangère au grand que le Surhomme dans sa bonté vous apparaît effroyable... »
C'est de ce passage, et d'aucun autre, qu'il faut partir pour comprendre ce que veut Zarathoustra :
la race d'hommes qu'il conçoit conçoit la réalité telle qu'elle est : ils sont assez forts pour cela ;
- la réalité n'est pas pour eux chose étrangère ni lointaine ; elle se confond avec eux :
ils ont en eux tout ce qu'elle a d'effrayant et de problématique car c'est à ce prix seul que l'homme peut être grand."
Ecce Homo, 1888.
Dans ses
Essais de psychologie contemporaine, qui valent bien la peine d'être lus, voici ce que Paul Bourget écrit :
"
(...)formule au premier abord très simple, mais qui se décompose à la réflexion en une série de caractères assez complexes.
L'homme supérieur se distingue de l'homme de génie, lequel est parfois assez inintelligent, et de l'homme de talent,
lequel n'est souvent qu'un spécialiste, par la capacité de se former sur toutes choses des idées générales.
Si cette capacité de généraliser ne s'accompagne point d'une égale capacité de création, l'homme supérieur reste un critique.
Si c'est le contraire, et si le pouvoir créateur subsiste côte à côte avec le pouvoir de comprendre,
l'homme supérieur devient une créature unique. Il fournit, en effet, le plus admirable type qu'il nous soit donné de concevoir :
celui du génie conscient. C'est, dans l'ordre politique, César; dans l'ordre de la peinture, Léonard; dans l'ordre des lettres, Goethe.
Même lorsqu'il ne monte point à ces sommets, l'homme supérieur est une des machines les plus précieuses
que la société ait à son service. Car l'universelle compréhension a, neuf fois sur dix, pour corollaire, l'universelle aptitude."
(...)
Imaginez maintenant que l'homme supérieur se trouve jeté par les hasards de sa naissance en plein courant démocratique,
et vous apercevrez quels contrastes du milieu et du caractère ont amené M. Renan à la conception d'un Idéal si contraire aux tendances
de notre pays."
D'autres auteurs, entre la fin du 18ème et le début du 20ème siècle, ont émis la même hypothèse :
Stendhal dans
Le Rouge et le Noir, quand il fait de Julien Sorel le fan de Napoléon ;
Dostoïevski dans
Crime et Châtiment, avec le problème de Raskolnikov ;
et Paul Bourget dans
le Disciple, avec le cas de Robert Greslou.
Pour ces trois-là, le surhumain, à travers l'image de l'homme supérieur, a fait question.
Après cette brève étude, nous pensons définitivement acquises les propositions suivantes :
- le surhumain n'est pas seulement un qualificatif ;
- le surhumain ne rentre pas dans un processus d'éducation, de dressage ou d'amélioration de l'Homme
(croyance en la société pour élever un type) ;
- le surhumain se regarde dans l'opposition entre deux idéaux : ascétique et aristocratique
(Nietzsche rejette la morale ascétique comme morale 'en soi', mais il ne la rejette pas comme morale 'tout court').
- le surhumain est un archétype mais surtout pas dans le sens 'saint, héros, génie' ;
Venons-en à la conclusion : le surhumain de Nietzsche est l'archétype du 'bon' au sens aristocratique.
Il peut être un homme (l'homme supérieur), un peuple (les Grecs), une période (la Renaissance), un style (classique),...
Il va de soi que si l'on considère l'homme supérieur comme incarnation du surhumain,
on écarte d'emblée la possibilité à Nietzsche de s'adresser aux femmes.
Aussi ce terme, comme celui de 'génie', de 'héros' ou de 'saint', est-il d'un désuet navrant ...
Ramené à la vie par
nécromancie et en dépit de sa réhabilitation par le corps enseignant - tentative bien malheureuse -
la place de Nietzsche, professeur universitaire au style journaleux, est aux côtés des écrivains fallacieux.
Le bon sens populaire, qui a si souvent raison contre la caste savante,
a donc eu raison de l'associer aux réactionnaires de la première moitié du 20ème siècle.
Peut-être, après ces lignes, estimerez-vous que nous n'avons guère ménagé un auteur si 'moderne' ?
Si tel est le cas, nous pensons qu'il est bon de rappeler ici l'avis de Tolstoï,
à lire au chapitre XI, dans son essai
Qu'est-ce que la religion ? (1902)
"
Mais le plus étonnant, c’est l’écart des questions fondamentales et leur dénaturation dans ce qu’on appelle maintenant la philosophie.
Il semblerait que la philosophie n’ait à résoudre qu’une question : que dois-je faire ?
Si, chez les philosophes des peuples chrétiens, on trouve des réponses, bien que mêlées d’explications embrouillées, inutiles,
comme par exemple, chez Spinoza, chez Kant, dans sa critique de la raison pratique, chez Schopenhauer,
et surtout chez Rousseau, cependant ces réponses existent. Mais dans les derniers temps,
depuis Hegel qui reconnaît que 'ce qui est réel est rationnel', la question : que dois-je faire ?
est passée au second plan, et la philosophie s’attache tout entière à l’étude de ce qui est,
et à son accord avec les théories faites d’avance. C’est le premier degré descendant.
Le deuxième degré inférieur de la pensée humaine, c’est la reconnaissance, comme loi fondamentale,
de la lutte pour l’existence par la seule raison qu’on peut observer cette lutte parmi les animaux et parmi les plantes.
Selon cette théorie, la perte des plus faibles est une loi à laquelle il ne faut pas mettre obstacle.
Enfin, arrive le troisième degré; l’originalité enfantine du demi-fou Nietzsche qui n’a même pas d’unité,
les esquisses des pensées immorales, sans fondement, sont reconnues par les hommes avancés
comme le dernier mot de la science philosophique. Dans la réponse à la question : que dois-je faire ? on dit déjà tout nettement :
vivre pour son plaisir sans faire attention à la vie des autres hommes.
Si quelqu’un doutait du terrible étourdissement, de l’abrutissement, atteints de notre temps par l’humanité chrétienne,
sans parler déjà des derniers crimes commis au Transvaal et en Chine, défendus par le clergé
et tenus pour des actes héroïques par les hommes tout-puissants du monde,
rien que le succès extraordinaire des œuvres de Nietzsche en serait une preuve indiscutable.
Paraissent des écrits sans lien, visant à l’effet de la façon la plus banale, les écrits d’un Allemand possédé de la manie des grandeurs,
hardi mais très borné et anormal. Ni par le talent, ni par le fond, ces écrits n’ont aucun droit à l’attention du public;
non seulement du temps de Kant, de Leibnitz, de Hume, mais même il y a cinquante ans de tels écrits n’auraient pas attiré l’attention,
mais même n’auraient pu paraître, et de nos jours, toute l’humanité soi-disant instruite admire le délire de M. Nietzsche,
le discute, l’explique et ses œuvres s’insèrent en toutes langues en un très grand nombre d’exemplaires.
Tourgueniev disait très spirituellement qu’il y a des lieux communs inverses souvent employés par des hommes incapables
qui désirent attirer à eux l’attention. Tous savent, par exemple, que l’eau mouille, et tout d’un coup, l’homme dit, d’un air sérieux,
que l’eau assèche — pas la glace — mais que l’eau assèche. Et cette affirmation prononcée avec éclat attire l’attention.
De même, tout le monde sait que la vertu consiste dans la restriction des passions et l’abnégation de soi-même.
Non seulement le Christianisme, contre lequel Nietzsche s’imaginait lutter, sait cela, mais c’est une loi éternelle,
supérieure, atteinte par toute l’humanité, par le Brahmanisme, le Bouddhisme, le Confucianisme, l’antique religion persane.
Et tout à coup, paraît un homme qui se déclare convaincu que l’abnégation de soi-même, la douceur, l’humilité, l’amour,
sont des vices qui perdent l’humanité. (Il a en vue le Christianisme en oubliant toutes les autres religions.)
On comprend très facilement qu’une telle affirmation frappe au premier moment. Mais en réfléchissant un peu,
et en ne trouvant dans l’ouvrage aucune preuve de cette affirmation étrange, tout homme raisonnable doit rejeter un livre pareil
et s’étonner que dans notre temps une telle bêtise puisse trouver un éditeur. Mais avec les livres de Nietzsche il n’en est pas ainsi.
La majorité des hommes soi-disant éclairés discutent sérieusement la théorie de la surhumanité et reconnaissent son auteur
comme le plus grand philosophe, l’héritier de Descartes, de Leibnitz et de Kant.
Et tout cela provient de ce que pour la majorité des hommes soi-disant éclairés de notre temps, le rappel de la vertu,
de sa base fondamentale, l’abnégation de soi-même, de l’amour, qui gêne et condamne leur vie bestiale, est désagréable,
et qu’ils ont du plaisir à rencontrer cette doctrine de l’égoïsme, de la cruauté, de l’édification de sa gloire et de son bonheur
aux dépens de la vie des autres hommes, cette doctrine selon laquelle ils vivent, bien qu’elle soit exprimée tant bien que mal,
sans ordre et sans lien."
- le surhumain d'Onfray -
Aucun ouvrage n'a soulevé chez nous autant d'objections, ligne par ligne,
que cette seconde partie du livre
la construction du surhomme consacrée à Nietzsche.
Comme nous nous adressons essentiellement à des amateurs d'énigmes, nous leur laisserons progressivement le soin de détailler,
proposition après proposition, ce qui nous distingue essentiellement de cet 'écrivain' et en quoi il nous apparaît être un tartuffe.
Ce qui manque, c'est ce qui fait la loyauté : cet esprit de recherche en commun avec le Lecteur.
Parmi le gros public, la plupart ne regardent qu'au résultat : s'il est en harmonie avec leurs sentiments,
ils supposent aussitôt que leur déduction en a été correcte;
et si elle leur paraît difficile, ils ne s'embarrassent pas outre-mesure : ils s'en remettent aux 'gens du métier'.
Il ne s'agit donc pas dans ce livre d'instruire mais de séduire.
"Il propose des exercices spirituels pour parvenir à la sagesse - Zarathoustra est le nom de cette sagesse,
le surhomme, la figure inédite d'un sage post-chrétien." (p. 196)
"La direction vers laquelle tout cela poussait, tendait ? La construction d'une sagesse existentielle personnelle." (p. 268)
"Le surhomme ne craint pas Dieu : il affirme que Dieu n'existe pas ;
il n'a pas peur de la mort ;
il sait souffrir ;
il jouit du monde comme il est : il affirme que le bonheur est possible.
Le surhomme formule une sagesse épicurienne intempestive." (p.270)
Petite vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Z5qC52TjOAgA présent, Nietzsche. Voici ce qu'affirme Zarathoustra :
"
Je vous enseigne le surhumain. L’homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu’avez-vous fait pour le surmonter ?
Tous les êtres jusqu’à présent ont créé quelque chose au-dessus d’eux,
et vous voulez être le reflux de ce grand flot et plutôt retourner à la bête que de surmonter l’homme ?
Qu’est le singe pour l’homme ? Une dérision ou une honte douloureuse.
Et c’est ce que doit être l’homme pour le surhumain : une dérision ou une honte douloureuse.
(...)
Le surhumain me tient au coeur, c’est lui qui est pour moi la chose unique, – et non point l’homme :
non pas le prochain, non pas le plus pauvre, non pas le plus affligé, non pas le meilleur. –
(...)
Ces maîtres d’aujourd’hui, surmontez-les-moi, ô mes frères, – ces petites gens :
c’est eux qui sont le plus grand danger du surhumain !
(...)
« L’homme doit devenir meilleur et plus méchant » – c’est ce que j’enseigne, moi.
Le plus grand mal est nécessaire pour le plus grand bien du surhumain."
On ne saurait imaginer plus grand contraste entre une vermine qui fait l'apologie d'une morale épicurienne,
et une autre qui fait celle d'une morale aristocratique.
Comme nos écrivains qui se donnent des airs de carabins, Onfray connaît jusqu'aux vers intestinaux de Nietzsche par le menu,
aussi a-t-il adopté une façon de penser qui fait l'apologie d'un genre de vie
littéraire latrinaire.
- le surhumain de l'auteure -
L'histoire de l'écolier Onfray et de son maître Nietzsche pourrait se résumer dans ce passage du
Faust de Goethe :
SCHÜLER
Doch ein Begriff muß bey dem Worte seyn.
MEPHISTOPHELES
Schon gut ! Nur muß man sich nicht allzu ängstlich quälen ;
Denn eben wo Begriffe fehlen ,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.
Mit Worten läßt sich trefflich streiten ,
Mit Worten ein System bereiten ,
An Worte läßt sich trefflich glauben ,
Von einem Wort läßt sich kein Jota rauben.
Retirez de Nietzsche : Wagner, Schopenhauer, Stendhal, Dostoïevski, Bourget.
Et considérez ce qui reste.
Les concepts : apollinien, dionysien, volonté de puissance, éternel retour, surhumain, décadence, morales de maîtres/ esclaves,
homme supérieur, etc... Ne lui appartiennent pas. Retirez aussi les majuscules qui font croire à de la profondeur où il n'y en a pas.
Le "philosophe" de Sils-Maria n'a jamais poussé la rhétorique jusqu'à émettre la moindre idée neuve, une seule vérité métaphysique.
Nous nous proposons donc de lui retirer définitivement le sceptre de disciple de Schopenhauer pour se l'approprier,
et donner au terme surhumain une toute autre interprétation :
Über Der Mensh, traduit par 'Sur l'Homme', 'à propos de l'Homme'...
Nietzsche part d'une opposition entre deux morales ;
son concept est issu d'un idéal aristocratique ;
son surhumain est limité au sens éthique, il est un
archétype.
L'auteure part d'une métaphysique ;
son concept s'applique donc aussi bien dans un sens logique, éthique ou esthétique;
son surhumain est un
avatar.
"
(...)allégoriquement, depuis le moment du péché originel jusqu'à la délivrance par la foi en la médiation du Dieu qui a pris corps (avatar)"
Schopenhauer, Théorie de la négation du vouloir-vivre,
LMVR.
Nietzsche a totalement écarté d'avance une telle hypothèse, limité qu'il était à des psychologies (?) de Jésus (comme Dostoïevski et Renan),
de Socrate et de Buddha ...
Pour Nietzsche, Socrate est un décadent. Pouvait-il être seulement autre chose ?
Socrate fait la preuve la plus claire de l'ignorance de son adversaire.
"Connais-toi toi-même", voilà bien ce qui était le plus difficile aux Grecs Antiques.
Aussi avaient-ils jugé bon de faire graver la divine sentence à l'entrée du temple de Delphes.
Le Socrate de Platon, qui n'a rien à voir avec un quelconque Socrate historique, est un être idéal :
il incarne le surhumain des Grecs antiques, l'accomplissement incarné de la sentence delphique.
Pour Nietzsche, Jésus est un idiot. Pouvait-il être seulement autre chose ?
Est chrétien tout le pathos qui consiste à ressentir les souffrances d'un dieu.
Ses souffrances sont inhumaines, surhumaines : Jésus n'inspire pas la pitié en tant qu'homme,
mais il révèle la condition humaine sous le regard divin.
"Ne résiste ni au mal ni aux méchants", la clé pour comprendre les Evangiles.
Le Jésus des Evangiles est une métaphore de l'accomplissement de la loi du Talion.
Tel était le surhumain pour les Juifs antiques.
Pour Nietzche, Buddha est un physiologiste. Pouvait-il être seulement autre chose ?
Si l'on s'en réfère à l'histoire de ce prince qui devint mendiant,
loin d'être une métaphore d'une 'émancipation finale' au sens moderne,
est bien plutôt une métaphore de l'étonnement qui surgit devant la vieillesse, la maladie, la souffrance et la mort.
Aussi Buddha n'apporte-il jamais de réponse, et affirme-t-il toujours que le monde est illusion.
Tel était le surhumain pour les Indiens antiques.
Pour Nietzsche, l'archétype est le surhomme. Pouvait-il être seulement autre chose ?
En Europe, pour Taine, il est le type régnant :
dans les cités libres, guerrières et esclavagistes de l'Antiquité, il est l'Apollon, le jeune homme nu et de belle race ;
Au Moyen-Age, au XIème siècle, il est le moine extatique ;
A la Renaissance, au XVème siècle, il est le baron solitaire et indépendant ;
Dans les Monarchies du XVIIème, il est le parfait homme de cour et de salon ;
Au XVIIIème, il est le Juif errant, le Don Juan, et le Faust insatiable.
... Sera-t-il, au XXIème, le fonctionnaire chinois ?
En totale opposition avec la thèse de l'archétype de Nietzsche, qui bascule en stéréotype,
la notion d'avatar est intéressante en ce qu'elle ouvre des portes sur le
rôle du masque dans les civilisations .
Cette idée mérite d'être développée, car elle seule permet un
rapprochement entre l'art et la religion.
Elle n'est pas limitée à l'être humain : elle s'applique aussi bien à des monstres (le 'sur-animal'),
à des statues (par exemple, l'image voilée de Saïs, David et Moïse de Michel-Ange),
à des animaux sacrés (l'embaumement des chats, des crocodiles, des ibis, des scarabées en Egypte),
à des objets sacrés (les artefacts archéologiques, les armes 'magiques' comme Excalibur ou Durandal).
Elle permet même d'entreprendre une généalogie en rapprochant les peuples par ce qu'ils ont en commun,
plutôt que de les 'fracturer en deux'.
Mais ceci - pour l'
heur - nous amènerait trop loin de notre sujet :
ores donc, ménageons nos Lecteurs.
[7] Dostoïevski est un écrivain qui a passé beaucoup de temps à guetter le moment de l'humiliation chez ses contemporains.
[8] Kant, qui concevait subjectivement l'idéalité du temps et de l'espace ...
[9] ... opposé à Einstein, pour qui le temps et l'espace sont relatifs, mais surtout objectifs.
[10] Dostoïevski,
Crime & Châtiment, chapitre IX.
[11] Le crime de Socrate n'est pas dans le raisonnement poussé jusqu'à la dialectique, propre à tous les Grecs antiques
(comme le prouvent les textes d'Hérodote : l'historien avait même proposé une 4ème hypothèse à la crue du Nil
à 3 autres qui étaient déjà grecques et cependant ignorées des prêtres Egyptiens).
L'ironie socratique est-elle comparable à notre sens moderne de la dérision ?
Le Socrate de Platon, qui connaissait tous les philosophes antérieurs, est plus qu'un mauvais citoyen,
qui pervertissait la jeunesse. Pourquoi était-il mis à l'honneur par l'Oracle de Delphes ?
Pourquoi Euripide lui demandait conseil pour ses pièces ?
Comme Jésus pour les Juifs antiques, Socrate est apparu aux Grecs antiques comme
un sauveur.
Socrate est une métaphore, l'idéalisation de l'objectivité, de la science, de la raison.
Mais cette objectivité a fini par faire pourrir l'art tragique jusqu'à lui donner la forme plus récente de la comédie attique
(cf
l'Origine de la Tragédie, Nietzsche).
[12] Un jeu de mot sur la célèbre avenue de Saint-Pétersbourg. Une autre perspective : un autre monde.
[13] (
bonus track : https://www.youtube.com/watch?v=Umhdm1QoF8w)
Un peu d'air : c'est le moment d'intercaler une ouverture.
Nous voilà plongés en pleine Renaissance, époque majeure de l'art pictural.
Le peintre de l'infini. - Comment Léonard de Vinci concevait-il ses oeuvres ?
Ses esquisses, fort nombreuses, témoignent d'un grand dessinateur : il saisissait sur le vif les scènes de la vie courante.
En revanche, ses tableaux, peu nombreux et si l'on en croît les biographes, montrent un homme fort lent et méticuleux pour la couleur.
On a souvent raillé Léonard de Vinci pour son goût pour les vêtements roses.
Si, malgré tout, nous voulions lui attribuer une couleur symbolique, le bleu semble plus indiqué.
Et davantage le bleu des montagnes lointaines que le bleu du ciel.
"
Je dis que l'azur qu'on voit dans l'atmosphère n'est point sa couleur spécifique,
mais qu'il est causé par la chaleur humide évaporée en menues et imperceptibles particules
que les rayons solaires attirent et font paraître lumineuses quand elles se détachent contre la profondeur
intense des ténèbres de la région qui forme un couvercle au-dessus d'elle." (Codex Leicester)
Autrement dit, la couleur bleue n'existe pas en elle-même mais par contraste avec l'obscurité de l'espace.
La théorie des couleurs qui concevait les couleurs comme étant issues de l'œil, trouve ici un écho intéressant.
Kant affirme que les couleurs ne sont pas des qualités des corps à l'intuition desquelles elles se rapportent,
mais seulement des modifications du sens de la vue, affecté par la lumière d'une certaine façon.
De plus, il est tout à fait remarquable de constater qu'en Inde on représente toujours Krishna
(Krichna, Kṛṣṇa, कृष्ण, sombre, bleu-noir, en sanskrit) en bleu,
qu'en Egypte, au temple de Séthi 1er à Abydos, Amon et Osiris sont également représentés en bleu,
et qu'ici à Florence, la couleur bleue ait encore été choisie pour évoquer la profondeur spirituelle, le calme, la paix et le divin.
Prenons les chefs d'œuvres de Léonard les plus célèbres : la Vierge aux Rochers (1483-1486), la Cène (1495-1498),
la Joconde (1503-1506) et la Vierge avec l'Enfant Jésus et Sainte Anne (1503-1519).
Tous attirent notre oeil vers l'arrière-plan où se trouve un
paysage idyllique où la profondeur est suggéré par la couleur bleue.
Ce paysage se retrouve dans son esquisse de la vallée de l'Arno de 1473.
Il y a toujours dans une oeuvre d'art une partie
significative et une partie
suggestive.
Le flambeau de l'artiste ne peut éclairer à la fois et l'esprit, et le cœur.
La partie significative c'est le visible, le style, la forme (sculpture), les mots (littérature), les notes (musique),
les couleurs (peinture), les matériaux (architecture)...
La partie suggestive c'est l'invisible, le fond, la face cachée de l'oeuvre, l'idée que veut y mettre l'artiste.
Médiocres sont les assiettes derrière la tête des statues des églises pour en faire des saints auréolés,
médiocres sont les cornes sur la tête du
Moïse.
Une oeuvre d'art ne devrait jamais représenter directement la partie suggestive.
Au contraire, tout, dans l'oeuvre d'art, dans la moindre de ses parties, devrait concourir à la suggestion d'une ou plusieurs idées.