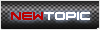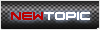Celimbrimbor a écrit:
À propos de cela, Aristide, en lisant les articles que tu m'avais passé, j'ai l'impression que la littérature et la géographie ont beaucoup plus en commun que ce que peuvent en penser les auteurs. En effet, à chaque fois, ils tentent une approche géographique de la littérature (ce que l'objet narratif révèle sur l'appropriation / investissement d'un territoire) mais est-ce que la géographie n'est pas, au départ, la lecture d'un territoire particulier ?
Bon, évidemment, on pourra me répondre que la lecture des couches sédimentaires, c'est vachement funky mais ce n'est pas forcément de l'analyse de texte.
Mais par rapport à la taxonomie ? Les noms de régions, villes, lieux et territoires ? Et puis même, la localisation humaine et ainsi de suite ? Je dis tout ceci en me fondant sur mes vieux cours d'analyse cartographique où j'ai pu bien galérer avant de saisir que finalement, la carte ( je sais qu'elle n'est pas le territoire, mais sa représentation, de même que le texte est une représentation que l'analyse doit expliquer ou faire advenir ) était un texte, ou une oeuvre, comme une autre.
Au final, le territoire est une histoire, certes gigantesque, mais demeure un texte, avec ses clefs.
Celim, qui file très, très, très loin, honteux.
Comme d'habitude avec toi, c'est très intéressant.
Je vais essayer de te répondre de deux façons : dans les règles de la discipline ; et avec mon point de vue personnel.
D'abord, selon les "règles" de la discipline, il est "difficile" de définir la géographie et d'en retracer sa genèse en oubliant que la discipline en elle même s'est "analysée" en fonction des évolutions des sciences sociales. Je m'explique : si on reste dans le contexte de l'invention de ce qu'on pourrait appeler la géographie, chez les grecs style Ératosthène par exemple, et bien elle mélange toute sorte de sciences à part entière aujourd'hui, et ne se limite pas qu'à la représentation d'un territoire (y a de la science naturelle, de l'astronomie, de la géologie, etc.). Il est difficile de penser "lecture" pour la géographie de l'époque. Concrètement, comme dirait le géographe spécialisé en géopolitique Yves Lacoste, elle sert avant tout à faire la guerre. Il n'est pas plus question de "lire" un territoire que de situer des lieux sur une feuille (ou un parchemin ou un papyrus, bref) où l'échelle est plus intelligible.
Maintenant, aujourd'hui, l'épistémologie de la matière en est arrivé à rendre la discipline très complexe... Elle est autant 'géophysique', que géomatique (à base d'indice, de modèle, de calculs informatiques, etc) ou géopoétique. Elle se définit avec des verbes qu'on pourrait citer dans l'ordre chronologique d'apparition :
voir (la géographie, c'est d'abord utiliser ses yeux pour observer ce qui nous entour),
organiser (c'est la géographie du premier XXème siècle, où on essaie de décrire le rapport de l'homme avec son espace, surtout à travers les espaces habités (notamment les villes)),
percevoir (ici on rentre dans l'héritage de la phénoménologie d'Heidegger ) et enfin, depuis une grosse vingtaine d'années, l'
exister. En cela, la géographie n'est pas à proprement parlé, d'après sa complexité, uniquement de la "lecture". Elle n'est pas que texte, ou récit, même si elle en est, en tant que majoritairement science humaine, extrêmement proche.
La notion de territoire est une notion complexe. On pense forcément au territoire représenté sur une carte par des frontières (là aussi, la frontière... belle notion de géographie) physique, administratif, politique, culturel... Mais le territoire peut être uniquement un espace "vécu". Là on rejoint les domaines que
Third_Eye maîtrise mieux que moi, à savoir l'ethnologie et l'anthropologie. Sans avoir besoin de lire des cartes, de lire des textes, de lire n'importe quel media, le territoire peut être uniquement une perception existentielle. On trouve ça chez les populations vivant dans des milieux de fortes contraintes et très proche de leur "nature".
En France, il a fallu attendre un ouvrage hautement philosophique, d'un géographe de l'après WWII, pour comprendre que le territoire, que la géographie n'était pas que carte et récit. Ce géographe trop en avance sur son temps à l'époque où il était "actif" a été redécouvert dans les années 80, et je le conseille très très très très chaudement à toi, mais à toute autre personne désireuse de creuser ce thème, et a permis une réelle "révolution" dans la pensée de la géographie : Eric Dardel,
L'homme et la Terre. C'est l'ouvrage qui m'a fait aimer la géographie avant toute autre chose.
Mon avis personnel sur la question, que je ne développerai pas vraiment parce qu'elle risque d'évoluer d'ici à un ou deux ans. Je suis d'accord avec toi. J'ai récemment lu un texte (mais alors, à l'heure où j'écris, j'ai un gros trou de mémoire sur son auteur... :/) développant le rapport entre le langage et la pensée. Et cet auteur explique l'idée selon laquelle avant qu'il y ait pensée, il faut un langage. Et la pensée ne peut se développer que s'il y a un développement du langage (et ce dernier se développerait surtout avec l'écriture et la multiplication du vocabulaire (si je me souviens bien, cette thèse lui a permis de critiquer cette baisse du vocabulaire dans le langage actuel, le côté "novlangue"). Ceci explique pourquoi les sciences, et dans notre cas la géographie, sont plus à même d'être dépendantes de la "lecture" aujourd'hui. Lecture de cartes, de textes, de paysages (que le langage permet de décrire)... C'est d'ailleurs sujet au capes ça : les sources en géographie (comme en histoire, "tout" est source, "tout" est objet géographique).
J'espère que j'ai pu répondre un peu à ta question.
Pour rester dans le topic... j'n'ai absolument pas lu les livres que j'envisageais de lire au début des vacances...

J'aurais dû m'en douter.
J'ai tellement été pris par Léon Bloy que j'ai lu d'autres livres de lui. Ce génie !
J'ai aussi lu le
De la Guerre de Clausewitz... Très intéressant, sur la tactique militaire. On comprend pourquoi il a tant inspiré et fait méditer par la suite.
Enfin, je me suis attaqué à
Sphères de Sloterdijk, et au
Phénomène Humain de Pierre Tailhard de Chardin. Je vous en dirais plus quand je les aurais lu et digéré.